C'est en regardant l'émission « Séquences jazz » sur la chaîne Mezzo en début de semaine – merci à toi, Mr Monstrueux d'avoir allumé le téléviseur au bon moment et d'avoir fait ce bon choix, c'est tout de même mieux que Comédie, non ? – qu'après avoir pu constater avec étonnement que le batteur jouant « Impressions » de John Coltrane aux côtés d'un Didier Lockwood pas très inspiré, à Vienne au mois d'août 2004, n'était autre qu'un certain Christian Vander, qu'une musique familière est venue chatouiller mes oreilles, celle d'un grand monsieur, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons jouant avec les deux complices de son actuel trio, Kiko Ruiz (guitare) et Negrito Trasante (percussions).
Avec cette note, je souhaite aussi adresser un clin d'oeil à mon ami Michel V., dont la passion pour la Musique (j'écris volontairement ce mot avec une majuscule) est intacte et toujours aussi débordante. C'est lui qui, voici pas mal d'années maintenant, m'a guidé sur les pas de nombreux artistes que je connaissais peu, voire pas du tout et qui tous, sans exception, se sont avérés pour moi de nouveaux compagnons de route. Je lui dois mes rencontres, entre autres, avec Henri Texier, Louis Sclavis ou le très grand Michel Portal. Renaud Garcia-Fons fut un beau jour l'objet d'une de nos conversations toujours enflammées...
Il faut tout de même que vous imaginiez un peu la scène... Avec Michel V., on est dans une autre dimension, car la musique n'entre pas chez lui dans le cadre d'une simple distraction, c'est un univers dans lequel il faut pénétrer avec respect, c'est un art majeur. Pas étonnant que nous soyons faits pour nous entendre ; avec lui, il faudrait, en quelques minutes, pouvoir tout écouter d'un seul coup, car le temps nous semble toujours compté, alors on met un premier disque sur la platine, on s'en délecte, puis, forcément, on pense à un autre et on change, et ainsi de suite, jusqu'à en avoir comme un tournis sonore assez unique ! Ça n'arrête pas, le feu d'artifice a commencé. Mais ces enchaînements frénétiques sont encore moins redoutables que les batailles de « blind tests » que nous nous livrons de temps à autre, dont le principe très simple consiste à faire deviner à l'autre ce qu'il donne à écouter, en souhaitant sans le dire le piéger, bien sûr ! Ou bien, c'est le contraire et un certain recueillement est de mise : Michel V. nous convie chez lui, ordre nous est donné de nous asseoir sur le canapé, à la place centrale positionnée rigoureusement à mi-chemin entre les deux hauts-parleurs et là, après un minutieux réglage des basses et des aigus... on ne bouge plus, on écoute ! C'est exactement de cette façon que j'ai pu entendre pour la première fois Renaud Garcia-Fons, c'était le disque « Oriental Bass », pour être précis.
Vous m'aurez pardonné, j'en suis certain, cette nouvelle parenthèse digressive, mais je la crois nécessaire pour vous faire vivre à mes côtés cette fièvre qui vous gagne dans ces instants de découverte. Oreilles grandes ouvertes, vous êtes disponible pour connaître – ce que j'oppose à reconnaître – et vous apprenez, vous ajoutez un nouveau livre à votre bibliothèque intérieure, s'il le faut, vous devez même créer un nouveau rayonnage. Vous mesurez avec bonheur l'étendue de votre ignorance, certes, mais vous avancez un peu, ces quelques pas vous aident à rester debout et vivant.
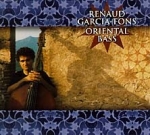 Concernant Renaud Garcia-Fons, parlons de lui tout de même puisqu'il est le sujet de ce texte, je serais bien en peine de vous proposer une quelconque classification musicale. La manie des étiquettes, sport franco-français, n'est pas mon fort et je ne saurais vous fournir ici que quelques indications géographiques ! D'origine ibérique, notre contrebassiste à cinq cordes puise une très grande partie de son inspiration du côté des rivages de la Méditerranée. L'Espagne forcément, mais aussi le Maghreb et le reste de l'Afrique. A travers tous les voyages qu'il nous propose – et à cet égard l'album « Navigatore » publié en 2001 est une bonne initiation puisque Renaud Garcia-Fons nous emmène avec lui pour un tour du monde à bord de sa Caravelle et nous donne aussi à entendre des musiques d'origine celtique ou d'Amérique du Sud – nous sommes conviés à l'ouverture vers l'Autre, sans restriction. Nous sommes là au coeur d'une démarche artistique universelle, peut-être même sommes-nous en présence de ce que l'on devrait considérer comme cette « world music », ouverte à tous les brassages, dont on nous rebat les oreilles dès lors qu'un chanteur ou musicien occidental s'empare d'un instrument un tant soit peu exotique à nos tympans formatés. Il est toutefois une condition nécessaire à la musique de Renaud Garcia-Fons : il faut que le soleil brille ! Méditerranée, quand tu nous tiens...
Concernant Renaud Garcia-Fons, parlons de lui tout de même puisqu'il est le sujet de ce texte, je serais bien en peine de vous proposer une quelconque classification musicale. La manie des étiquettes, sport franco-français, n'est pas mon fort et je ne saurais vous fournir ici que quelques indications géographiques ! D'origine ibérique, notre contrebassiste à cinq cordes puise une très grande partie de son inspiration du côté des rivages de la Méditerranée. L'Espagne forcément, mais aussi le Maghreb et le reste de l'Afrique. A travers tous les voyages qu'il nous propose – et à cet égard l'album « Navigatore » publié en 2001 est une bonne initiation puisque Renaud Garcia-Fons nous emmène avec lui pour un tour du monde à bord de sa Caravelle et nous donne aussi à entendre des musiques d'origine celtique ou d'Amérique du Sud – nous sommes conviés à l'ouverture vers l'Autre, sans restriction. Nous sommes là au coeur d'une démarche artistique universelle, peut-être même sommes-nous en présence de ce que l'on devrait considérer comme cette « world music », ouverte à tous les brassages, dont on nous rebat les oreilles dès lors qu'un chanteur ou musicien occidental s'empare d'un instrument un tant soit peu exotique à nos tympans formatés. Il est toutefois une condition nécessaire à la musique de Renaud Garcia-Fons : il faut que le soleil brille ! Méditerranée, quand tu nous tiens...
Mais le plus remarquable est ce sentiment qui vous gagne et vous fait croire que la musique de Renaud Garcia-Fons est accessible à toutes les oreilles, qu'elle ne nécessite aucune « initiation » particulière. Elle coule d'évidence, de simplicité et d'élégance, sans pour autant être dénuée d'une bonne dose de virtuosité. Un heureux mariage entre simplicité et créativité, sans complexe. Peut-être aussi une certaine définition de l'exigence.
Il y a quelques années, j'avais eu la chance d'assister à un concert de Renaud Garcia-Fons dans la magnifique salle de l'Arsenal à Metz. Entouré de cinq ou six musiciens – ma mémoire me fait défaut, je me souviens seulement de la présence des deux actuels membres de son trio à la guitare et aux percussions – le contrebassiste avait déroulé son magnifique tapis musical durant 90 minutes qui sont passées à la vitesse de l'éclair. Sa présence physique discrète contrastait étrangement avec la force du propos et une certaine manière de se tenir bien droit, un peu fièrement – tel le toréador ? – et nous étions sortis comme hébétés après avoir reçu ce que j'appelle un peu religieusement une offrande. Pas une seconde de tricherie, un talent fou et toujours ce brassage harmonieux, partant d'une introduction en solo aux intonations classiques pour aller jusqu'aux sonorités rock d'une contrebasse électrifiée et gémissant un magnifique chorus à l'archet. Renaud Garcia-Fons, encore un passeur, un de ces artistes trans-courants dont nous avons tant besoin.
Il n'y a rien à jeter dans la discographie de Renaud Garcia-Fons, c'est un parcours jusque-là sans faute et c'est avec bonheur que l'année 2006 a vu la publication d'un beau disque live, « Arcoluz », doublé d'un DVD. Peut-être pourrais-je vous recommander de commencer votre voyage avec lui en écoutant « Oriental Bass » ou « Navigatore » ? Mais si vous vous prenez au jeu, vous constaterez bien vite chez vous monter le besoin pressant d'en écouter un peu plus, et un peu plus encore.
C'est donc le moment de commencer...
Discographie :
- Légendes (1993)
- Alborea (1995)
- Oriental Bass (1997)
- Fuera (1999)
- Navigatore(2001)
- Entremundo (2004)
- Arcoluz (2006)
On peut se procurer directement tous ces beaux disques sur le label Enja
On écoute ?
Un petit bonus avec cet extrait de "Navigatore", que l'on trouve sur l'album éponyme.
 Car enfin, quelle faute impardonnable Eric Barret a-t-il bien pu commettre pour voir le compte de sa dernière production ainsi réglé en quelques phrases ? Se serait-il lié les pieds et les poings avec des médias qui nous auraient conséquemment abreuvé de sa musique jusqu'à plus soif et écoeurement, moyennant je ne sais quelle transaction financière avec une « major » complice ? Serait-il le chouchou de ces radios FM dont la programmation dégouline dans les tympans d'une foule consommatrice cible des dernières trouvailles du marketing le plus cynique ? Aurait-il forcé la porte de nos grandes chaînes de télévision "populaires" pour devenir le membre attitré d'un jury chargé de fabriquer le prochain génie chantant de la décennie, juste avant son inexorable plongeon dans l'oubli ? Aurait-il reçu une récompense injustifiée et médiatique lors d'un palmarès annuel ? Se serait-il, ne fût-ce qu'une seule fois, laissé abuser par un courant musical à la mode, au détriment de la cohérence de sa démarche personnelle ? Rien de tout cela. La musique d'Eric Barret évolue dans une certaine confidentialité – inhérente à ses choix artistiques, probablement – au point que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de lui. J'ai la chance de connaître un peu ce monsieur. D'abord parce que je l'ai déjà vu sur scène (j'ai le souvenir d'un très bon concert en trio avec le guitariste Serge Lazarévitch et le batteur Joël Allouche), ensuite parce que je possède quelques uns de ses disques, dont le magnifique « New Shapes » ou encore « Linkage », très beau duo avec le batteur Simon Goubert dans ce qui ressemble fort à un hommage à un autre duo, celui formé par John Coltrane et Rashied Ali en 1967 pour la session « Intersellar Space ». Enfin, parce qu'ayant été le professeur de saxophone de mon Saxoman de fils durant plusieurs années, j'ai ouï dire de ses qualités de pédagogue et pour l'avoir rapidement côtoyé, je sais que l'homme est discret, sincère et... bourré de talent, toujours en recherche ! Et puis, pour l'histoire, souvenons-nous qu'en 1985, alors qu'il n'était âgé que de 26 ans, Éric Barret enregistrait un disque en trio avec Henri Texier et Aldo Romano, excusez du peu. C'est aussi à cette époque qu'on pouvait l'écouter au Sunset comme invité du très coltranien trio de Christian Vander (avec Michel Graillier et Alby Cullaz). Alors si « My favorite songs » (un titre clin d'oeil à Coltrane, une fois encore, car qui n'a jamais entendu parler de « My favorite things », l'un de ses disques les plus célèbres ? Vous, là, au fond de la classe ? C'est bon, passez me voir à la fin de l'heure, merci.) n'a pas l'heur de recueillir l'adhésion totale d'un chroniqueur musical, pourquoi passer ainsi sous silence ce qui fait l'intérêt de ce disque et appuyer sur ce qui semble à première vue une série de faiblesses ? Je l'ignore et j'éprouve ici le besoin de redresser une barre que j'estime injustement tordue !
Car enfin, quelle faute impardonnable Eric Barret a-t-il bien pu commettre pour voir le compte de sa dernière production ainsi réglé en quelques phrases ? Se serait-il lié les pieds et les poings avec des médias qui nous auraient conséquemment abreuvé de sa musique jusqu'à plus soif et écoeurement, moyennant je ne sais quelle transaction financière avec une « major » complice ? Serait-il le chouchou de ces radios FM dont la programmation dégouline dans les tympans d'une foule consommatrice cible des dernières trouvailles du marketing le plus cynique ? Aurait-il forcé la porte de nos grandes chaînes de télévision "populaires" pour devenir le membre attitré d'un jury chargé de fabriquer le prochain génie chantant de la décennie, juste avant son inexorable plongeon dans l'oubli ? Aurait-il reçu une récompense injustifiée et médiatique lors d'un palmarès annuel ? Se serait-il, ne fût-ce qu'une seule fois, laissé abuser par un courant musical à la mode, au détriment de la cohérence de sa démarche personnelle ? Rien de tout cela. La musique d'Eric Barret évolue dans une certaine confidentialité – inhérente à ses choix artistiques, probablement – au point que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de lui. J'ai la chance de connaître un peu ce monsieur. D'abord parce que je l'ai déjà vu sur scène (j'ai le souvenir d'un très bon concert en trio avec le guitariste Serge Lazarévitch et le batteur Joël Allouche), ensuite parce que je possède quelques uns de ses disques, dont le magnifique « New Shapes » ou encore « Linkage », très beau duo avec le batteur Simon Goubert dans ce qui ressemble fort à un hommage à un autre duo, celui formé par John Coltrane et Rashied Ali en 1967 pour la session « Intersellar Space ». Enfin, parce qu'ayant été le professeur de saxophone de mon Saxoman de fils durant plusieurs années, j'ai ouï dire de ses qualités de pédagogue et pour l'avoir rapidement côtoyé, je sais que l'homme est discret, sincère et... bourré de talent, toujours en recherche ! Et puis, pour l'histoire, souvenons-nous qu'en 1985, alors qu'il n'était âgé que de 26 ans, Éric Barret enregistrait un disque en trio avec Henri Texier et Aldo Romano, excusez du peu. C'est aussi à cette époque qu'on pouvait l'écouter au Sunset comme invité du très coltranien trio de Christian Vander (avec Michel Graillier et Alby Cullaz). Alors si « My favorite songs » (un titre clin d'oeil à Coltrane, une fois encore, car qui n'a jamais entendu parler de « My favorite things », l'un de ses disques les plus célèbres ? Vous, là, au fond de la classe ? C'est bon, passez me voir à la fin de l'heure, merci.) n'a pas l'heur de recueillir l'adhésion totale d'un chroniqueur musical, pourquoi passer ainsi sous silence ce qui fait l'intérêt de ce disque et appuyer sur ce qui semble à première vue une série de faiblesses ? Je l'ignore et j'éprouve ici le besoin de redresser une barre que j'estime injustement tordue !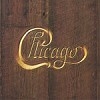 Forcément – tout cela va vous paraître répétitif – c'est mon frère qui m'avait fait découvrir ce groupe américain dont la musique, bourrée d'énergie jusqu'à la gueule, reposait sur un savant cocktail alliant la précision d'un trio de souffleurs hors pair (James Pankow, Lee Loughnane et Walter Parazaider), la rage électrique d'un guitariste exceptionnel (Terry Kath), l'élégance presque british d'un pianiste arrangeur (Robert Lamm) et les incursions plus « variétés » du bassiste chanteur Peter Cetera... auxquels on ne manquera pas d'ajouter l'excellent batteur et inventif percussioniste Danny Seraphine. Avec Chicago et ses sept musiciens, on naviguait dans l'océan d'une musique où les influences du jazz venaient se fracasser avec bonheur sur le blues et le rock, un régal pour toute oreille avide de brassage et de mariages heureux. Avec Chicago (qui s'appelait à l'origine Chicago Transit Authority, nom de la compagnie de transport de la ville), on était servi... et bien ! Le groupe alignait des albums doubles, identifiables facilement par un numéro qui leur servait de titre : trois monuments pour commencer avant de nous servir une somme live sous la forme d'un... quadruple trente-trois tours (aujourd'hui réédité avec une heure de musique supplémentaire, je dis cela au cas où...). Tout ceci entre 1967 et 1971, quatre années d'une productivité phénoménale et de succès mondiaux dont les plus célèbres furent « Questions 67 and 68 » et « 25 or 6 to 4 ». Mais surtout, je crois maintenant pouvoir affirmer que c'est avec Chicago que j'ai pu faire entrer les sonorités du jazz dans mon propre univers. Jusque là, la musique s'appelait rock, elle devait être guitare, basse et batterie, parfois piano aussi. Mais j'étais peu sensible aux appels de la trompette, du trombone, de la flûte ou du saxophone ! Etonnant quand on sait que mon propre fils est saxophoniste et que, peut-être, sa vocation est en partie née du fait que depuis sa naissance, il a dû subir des heures et des heures durant lesquelles John Coltrane était au centre de bien des explorations. Mais oui, j'en suis sûr maintenant, c'est avec Chicago que ces instruments sont devenus pour moi de vrais compagnons de route...
Forcément – tout cela va vous paraître répétitif – c'est mon frère qui m'avait fait découvrir ce groupe américain dont la musique, bourrée d'énergie jusqu'à la gueule, reposait sur un savant cocktail alliant la précision d'un trio de souffleurs hors pair (James Pankow, Lee Loughnane et Walter Parazaider), la rage électrique d'un guitariste exceptionnel (Terry Kath), l'élégance presque british d'un pianiste arrangeur (Robert Lamm) et les incursions plus « variétés » du bassiste chanteur Peter Cetera... auxquels on ne manquera pas d'ajouter l'excellent batteur et inventif percussioniste Danny Seraphine. Avec Chicago et ses sept musiciens, on naviguait dans l'océan d'une musique où les influences du jazz venaient se fracasser avec bonheur sur le blues et le rock, un régal pour toute oreille avide de brassage et de mariages heureux. Avec Chicago (qui s'appelait à l'origine Chicago Transit Authority, nom de la compagnie de transport de la ville), on était servi... et bien ! Le groupe alignait des albums doubles, identifiables facilement par un numéro qui leur servait de titre : trois monuments pour commencer avant de nous servir une somme live sous la forme d'un... quadruple trente-trois tours (aujourd'hui réédité avec une heure de musique supplémentaire, je dis cela au cas où...). Tout ceci entre 1967 et 1971, quatre années d'une productivité phénoménale et de succès mondiaux dont les plus célèbres furent « Questions 67 and 68 » et « 25 or 6 to 4 ». Mais surtout, je crois maintenant pouvoir affirmer que c'est avec Chicago que j'ai pu faire entrer les sonorités du jazz dans mon propre univers. Jusque là, la musique s'appelait rock, elle devait être guitare, basse et batterie, parfois piano aussi. Mais j'étais peu sensible aux appels de la trompette, du trombone, de la flûte ou du saxophone ! Etonnant quand on sait que mon propre fils est saxophoniste et que, peut-être, sa vocation est en partie née du fait que depuis sa naissance, il a dû subir des heures et des heures durant lesquelles John Coltrane était au centre de bien des explorations. Mais oui, j'en suis sûr maintenant, c'est avec Chicago que ces instruments sont devenus pour moi de vrais compagnons de route...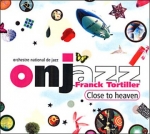 vous venez de publier le dix-neuvième opus d'une formation dite « institutionnelle », l'Orchestre National de Jazz, dont les 20 années d'existence ont vu se succéder, si mes comptes sont exacts, huit directeurs. Après François Jeanneau, Antoine Hervé, Claude Barthélémy (à deux reprises), Denis Badault, Laurent Cugny, Didier Levallet et Paolo Damiani, vous voici à la tête d'un orchestre réjouissant dont la récente production discographique me ravit à plus d'un titre !
vous venez de publier le dix-neuvième opus d'une formation dite « institutionnelle », l'Orchestre National de Jazz, dont les 20 années d'existence ont vu se succéder, si mes comptes sont exacts, huit directeurs. Après François Jeanneau, Antoine Hervé, Claude Barthélémy (à deux reprises), Denis Badault, Laurent Cugny, Didier Levallet et Paolo Damiani, vous voici à la tête d'un orchestre réjouissant dont la récente production discographique me ravit à plus d'un titre !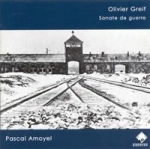 Durant plusieurs étés consécutifs, pendant la deuxième quinzaine de juillet plus exactement, j'ai eu la chance d'assister, chaque soir ou presque, à un concert de musique dite « classique » sous un chapiteau bondé de monde. Car en effet, la station alpine des Arcs organise depuis trois décennies une académie dont le principe consiste à réunir bon nombre de musiciens issus des différents conservatoires de notre belle France et de leur proposer de travailler durant la journée sous la férule d'un enseignant chevronné. Et pour les estivants qui choisissent d'aller s'oxygéner là-haut, entre 1600 et 1800 mètres d'altitude, un rendez-vous presque incontournable leur est proposé à partir de 20h30, sous la forme d'une soirée musicale gratuite où viennent se produire la plupart des musiciens chargés d'enseigner pendant la journée, mais aussi d'autres solistes invités pour l'occasion. Ce festival est une excellente manière de ne pas « marcher idiot » et d'aller à la rencontre d'une expression artisitique dont le répertoire allie un vrai classicisme à de nombreuses échappées vers des univers musicaux plus avant-gardistes, au grand dam d'une partie de l'auditoire, dont la curiosité semble s'être arrêtée au stade de la reconnaissance rassurante, alors qu'il est pourtant si essentiel de chercher à connaître.
Durant plusieurs étés consécutifs, pendant la deuxième quinzaine de juillet plus exactement, j'ai eu la chance d'assister, chaque soir ou presque, à un concert de musique dite « classique » sous un chapiteau bondé de monde. Car en effet, la station alpine des Arcs organise depuis trois décennies une académie dont le principe consiste à réunir bon nombre de musiciens issus des différents conservatoires de notre belle France et de leur proposer de travailler durant la journée sous la férule d'un enseignant chevronné. Et pour les estivants qui choisissent d'aller s'oxygéner là-haut, entre 1600 et 1800 mètres d'altitude, un rendez-vous presque incontournable leur est proposé à partir de 20h30, sous la forme d'une soirée musicale gratuite où viennent se produire la plupart des musiciens chargés d'enseigner pendant la journée, mais aussi d'autres solistes invités pour l'occasion. Ce festival est une excellente manière de ne pas « marcher idiot » et d'aller à la rencontre d'une expression artisitique dont le répertoire allie un vrai classicisme à de nombreuses échappées vers des univers musicaux plus avant-gardistes, au grand dam d'une partie de l'auditoire, dont la curiosité semble s'être arrêtée au stade de la reconnaissance rassurante, alors qu'il est pourtant si essentiel de chercher à connaître. Voici maintenant pas loin de 40 ans (37 pour être précis), ma « truffe auditive » commença à flairer dans les ondes ambiantes que le monde de la musique n'était pas seulement celui que me donnait à entendre une diffusion radiophonique plutôt pépère et conformiste (ce qui, entre nous, n'a guère changé depuis malgré l'apparition des radios prétendûment libres qui, aujourd'hui sous la tutelle de deux ou trois grands groupes financiers, ne sont pour la plupart de que de simples robinets d'où coule à flots ininterrompus une dégoulinante mélasse sonore). Il existait donc autre chose que Claude François, Johnny Halliday, Hervé Vilard ou bien encore Alain Barrière ? Je reviendrai un jour en détail sur le parcours que j'ai effectué depuis, de découverte en découverte, chacune englobant la précédente sans l'exclure, un cheminement sans fin dont je ne peux que souhaiter la poursuite jour après jour, mais en attendant, j'aimerais raconter (brièvement, le plus brièvement possible, sinon on va encore me taxer de parenthèses et de prolixité) une première rencontre musicale qui, aujourd'hui encore, m'enchante toujours par sa démarche sincère et bourrée d'energie. Celle d'un groupe américain appelé Creedence Clearwater Revival. Ce quatuor devenu trio sur la fin est très probablement pour moi l'une de mes premières « madeleines de Proust » et il est resté sans le moindre doute un véritable « compagnon d'une vie ». Ecouter un disque de Creedence, c'est pour moi – automatiquement – replonger dans cette période étrange qui me faisait passer de l'enfance à l'adolescence. C'est aussi, d'une certaine façon, me tourner vers mes racines.
Voici maintenant pas loin de 40 ans (37 pour être précis), ma « truffe auditive » commença à flairer dans les ondes ambiantes que le monde de la musique n'était pas seulement celui que me donnait à entendre une diffusion radiophonique plutôt pépère et conformiste (ce qui, entre nous, n'a guère changé depuis malgré l'apparition des radios prétendûment libres qui, aujourd'hui sous la tutelle de deux ou trois grands groupes financiers, ne sont pour la plupart de que de simples robinets d'où coule à flots ininterrompus une dégoulinante mélasse sonore). Il existait donc autre chose que Claude François, Johnny Halliday, Hervé Vilard ou bien encore Alain Barrière ? Je reviendrai un jour en détail sur le parcours que j'ai effectué depuis, de découverte en découverte, chacune englobant la précédente sans l'exclure, un cheminement sans fin dont je ne peux que souhaiter la poursuite jour après jour, mais en attendant, j'aimerais raconter (brièvement, le plus brièvement possible, sinon on va encore me taxer de parenthèses et de prolixité) une première rencontre musicale qui, aujourd'hui encore, m'enchante toujours par sa démarche sincère et bourrée d'energie. Celle d'un groupe américain appelé Creedence Clearwater Revival. Ce quatuor devenu trio sur la fin est très probablement pour moi l'une de mes premières « madeleines de Proust » et il est resté sans le moindre doute un véritable « compagnon d'une vie ». Ecouter un disque de Creedence, c'est pour moi – automatiquement – replonger dans cette période étrange qui me faisait passer de l'enfance à l'adolescence. C'est aussi, d'une certaine façon, me tourner vers mes racines.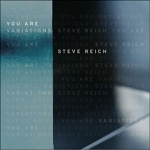 Publié à la fin de l'année 2005 et enregistré entre septembre 2003 et mars 2005, "You are (Variations)" est le nouvel opus de ce grand compositeur américain qu'est Steve Reich. Quasiment inclassable, même si certains le rangent assez sommairement au rayon des tenants de la "musique sérielle", notre homme est loin d'être un débutant. On s'en convaincra à l'écoute d'un somptueux coffret appelé "Works 1965-1995" (présenté dans ma petite sélection ci-contre) où toutes les facettes de ce musicien hors normes sont exposées, nous invitant à plonger dans un univers mystérieux et habité par la grâce. Avec un travail sur les rythmes absolument prodigieux - il a en particulier beaucoup étudié les musiques balinaises - Steve Reich sait nous envoûter grâce à un sens inégalé des enchevêtrements et des décalages sonores où piano, choeurs et marimbas occupent une place de choix. Ce disque est composé en fait de deux parties principales : la première en quatre mouvements, intitulée "You are (Variations)" est interprétée par le Los Angeles Master Chorale, sous la direction de Grant Gershon. La seconde, "Cello Counterpoint", est une pièce en trois mouvements pour huit violoncelles, interprétée par Maya Beiser, qui a fait appel pour l'occasion à la technique de re-recording.
Publié à la fin de l'année 2005 et enregistré entre septembre 2003 et mars 2005, "You are (Variations)" est le nouvel opus de ce grand compositeur américain qu'est Steve Reich. Quasiment inclassable, même si certains le rangent assez sommairement au rayon des tenants de la "musique sérielle", notre homme est loin d'être un débutant. On s'en convaincra à l'écoute d'un somptueux coffret appelé "Works 1965-1995" (présenté dans ma petite sélection ci-contre) où toutes les facettes de ce musicien hors normes sont exposées, nous invitant à plonger dans un univers mystérieux et habité par la grâce. Avec un travail sur les rythmes absolument prodigieux - il a en particulier beaucoup étudié les musiques balinaises - Steve Reich sait nous envoûter grâce à un sens inégalé des enchevêtrements et des décalages sonores où piano, choeurs et marimbas occupent une place de choix. Ce disque est composé en fait de deux parties principales : la première en quatre mouvements, intitulée "You are (Variations)" est interprétée par le Los Angeles Master Chorale, sous la direction de Grant Gershon. La seconde, "Cello Counterpoint", est une pièce en trois mouvements pour huit violoncelles, interprétée par Maya Beiser, qui a fait appel pour l'occasion à la technique de re-recording. Après douze ans d'un long silence, Kate Bush nous revient avec "Aerial", un double CD dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne décevra pas les fans de la première heure, ceux qui en particulier étaient tombés sous le charme de cette voix si particulière dont les compositions phares s'appelaient "Wuthering Heights" ou "Babooshka", à la fin des années 70.
Après douze ans d'un long silence, Kate Bush nous revient avec "Aerial", un double CD dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne décevra pas les fans de la première heure, ceux qui en particulier étaient tombés sous le charme de cette voix si particulière dont les compositions phares s'appelaient "Wuthering Heights" ou "Babooshka", à la fin des années 70.